Texte & Publication
Groupov - Vers une solution imparfaite - 2016
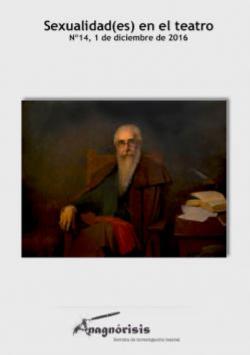
| Catégorie : | |
| Auteur : | Jacques Delcuvellerie |
| Tiré de : | Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº. 14, diciembre de 2016 |
| Date : | 2016 |
Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº. 14, diciembre de 2016
Le Groupov
Jacques Delcuvellerie, né le 26 mars 1946 à Lille, est un homme de théâtre, metteur en scène, pédagogue, auteur et acteur français résidant en Belgique.
Il a étudié les arts plastiques à l’École supérieure des arts Saint-Luc à Tournai, la communication sociale à l'Institut de Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) à Tournai avant d'obtenir un master Théâtre et techniques de communication auprès de l'Institut national supérieur des arts du spectacle (INSAS) de Bruxelles.
Une partie importante de l’activité professionnelle de Jacques Delcuvellerie jusqu’en 1989 a été la production et création de programmes culturels, musicaux et dramatiques sur les ondes de la radio-télévision belge d’expression française (RTBF). Il y a, notamment, présenté pendant 11 ans (1976-1986) l’émission « Videographie » exclusivement consacrée à l’émergence et aux créations marquantes de l’art vidéo à travers le monde.
Jacques Delcuvellerie a également consacré une grande énergie, depuis les années 70, à l’élaboration collective d’une pédagogie originale de formation de l’acteur au Conservatoire de Liège, aujourd’hui Ecole Supérieure d’Acteurs ESACT). Les principes de cet enseignement, auquel il a pu donner sa forme la plus radicale en y dirigeant, pendant quelques années, un Studio Expérimental – sont réunis dans son article « Le Jardinier ». Il a réalisé de nombreuses mises en scènes d’oeuvres du répertoire classique et contemporain. Par exemple, la création mondiale de l’opéra MEDEA MATERIAL (texte Heiner Müller, musique Pascal Dusapin, direction musicale Philippe Herreweghe). Cependant, l’essentiel de son activité artistique a été consacrée au Groupov.
Groupov
Le Groupov est un collectif d’artistes de différentes disciplines et différentes nationalités (Français, Belges (Wallons et Flamands), Italiens, Américain…). Fondé en 1980 par Jacques Delcuvellerie qui est demeuré jusqu’à ce jour son directeur artistique, il est basé à Liège, Belgique.
Depuis ses origines le Groupov a mené conjointement des projets purement expérimentaux, dont certains hors du champ théâtral (performances, installations, concerts, films et vidéos, etc.) et des créations dramatiques originales.
Pendant les années 90, il a orienté ses recherches sur « la question de la question de la vérité ». Au terme de ce parcours et notamment après la création de TRASH (A LONELY PRAYER) de Marie-France Collard et Jacques Delcuvellerie et la mise en scène de LA MÈRE de Bertolt Brecht, le Groupov a élaboré pendant quatre ans un projet sur le génocide de 1994 au Rwanda. Après la présentation de la dernière étape de ce work in progress au Festival d’Avignon (1999), la forme définitive du spectacle a été créée en avril 2000 – RWANDA 94, UNE TENTATIVE DE RÉPARATION SYMBOLIQUE ENVERS LES MORTS, À L’USAGE DES VIVANTS. Le spectacle a poursuivi une tournée internationale durant près de cinq ans. Le texte en a été publié aux Editions Théâtrales et un film de Marie-France Collard et Patrick Czaplinski en a été réalisé. Ce film est encore régulièrement utilisé lors de colloques universitaires, workshops ou séminaires (Europe, USA, Japon, etc.) Il a également donné lieu à des documentaires et de nombreuses publications.
Le Groupov s’est défini comme Centre Expérimental de Culture Active, afin de bien marquer que son activité ne s’inscrit pas exclusivement dans le champ théâtral, même si celui-ci reste le plus visible. C’est ainsi que, parmi bien d’autres recherches, le Groupov – poursuivant une partie du travail initié par Grotowski dans sa période post-théâtrale (projet « Montagne », etc.) – a élaboré une structure de travail de 5 jours et 5 nuits dans la nature et surtout en forêt LES CLAIRIÈRES, qui a évolué pendant plusieurs années.
Après RWANDA 94 et ANATHÈME (Avignon 2005), le Groupov s'est engagé dans une nouvelle aventure, en gestation de longue date : UN UOMO DI MENO (FARE THEE WELL TOVARITCH HOMO SAPIENS) – UN HOMME DE MOINS (ADIEU CAMARADE HOMO SAPIENS). Spectacle fleuve de sept heures écrit et mis en scène par Jacques Delcuvellerie – après une longue phase de recherches collectives. UN UOMO DI MENO a été salué unanimement par le public et la critique.
Parallèlement, le Groupov apporte son soutien résolu à différents projets portés par de jeunes artistes, lesquels sont généralement issus de l’Ecole Supérieure d’Acteurs de Liège, dont la pédagogie a toujours entretenu d’étroites relations avec l’expériences Groupov.
Vers une solution imparfaite
« Le Groupov est une entreprise expérimentale
au sens premier du terme : celui de la traversée
d’un territoire inconnu. Par contre, il ne
constitue pas un laboratoire lequel, par
définition, simule et réduit les terrains de
l’expérience pour s’en assurer la maîtrise. »
Éric Duyckaerts1
Qu’un collectif d’artistes, notamment voué au théâtre, qui n’a jamais postulé la direction d’une institution existante ni fondé lui-même aucune maison programmant chaque saison des spectacles et visant à accueillir un public régulier, qu’une telle entreprise uniquement vouée à l’expérimentation et à la création, à son propre rythme, ait pu survivre plus de 35 ans, constitue sans doute un phénomène rare et singulier.
Dans un article comme celui-ci, je ne tenterai pas de raconter cette histoire complexe et mouvementée, ni même d’exposer de manière argumentée la vision et les principes, les pratiques qui ont animé cette aventure. J’ai consacré un livre à une tentative exhaustive dans ce genre et je n’aurai ni le goût, ni la capacité d’en tirer un résumé.2 Je propose donc simplement ici quelques points de repères, quelques anecdotes même, qui – peut-être – pourraient aider à sentir voire, parfois, à saisir ce qui s’est cherché entre nous pendant ces trois décennies.
1. Au commencement
Tout commence en janvier 1980, un moment, bien au-delà du phénomène punk, que beaucoup d’entre nous vivaient comme celui du « No Future ». Après les explosions et les expérimentations exubérantes des années 60, dans tous les domaines : bouleversements des comportements individuels et collectifs, expressions artistiques, parfois aux limites d’elles-mêmes (de John Cage au collectif Dziga Vertov (Godard/Gorin), du Living Theatre aux performances Fluxus, à Black Mountain College, à la Kitchen, au tout premier Bob Wilson, au Free Jazz, etc.) il semblait aux jeunes gens qui allaient avec moi créer le Groupov, que tout avait déjà été fait ou tenté et que plus rien d’inaugural, de réellement nouveau (ce terme totalement prostitué et galvaudé aujourd’hui) c’est-à-dire d’original, au sens littéral d’in-ouï, n’était possible. Non seulement cela, mais encore que tenter ou même simplement rêver de faire surgir ou d’éveiller – comme dit le personnage de James Joyce : « La beauté qui n’a pas encore paru au monde », que cette attitude était perçue comme une sorte de mégalomanie désuète, voire ridicule.
Nous vivions très fortement, je dirais : viscéralement, cette contradiction : plus rien ne peut s’inventer qui ne soit autre chose qu’une déclinaison plus ou moins habile, séduisante ou réductrice, des créateurs majeurs depuis Dada et Duchamp jusqu’aux sixties et, en même temps, sans cette sensation d’accoucher de l’in-ouï, créer semble une entreprise vaine, dans tous les sens du terme.
Cependant, nous voulions à tout prix mettre en jeu « quelque chose » dont nous nous sentions porteurs sans pouvoir le définir.
De cette contradiction sont nées des expériences et des tentatives qui incarnaient une attitude qu’un écrivain qualifia un jour de « deuil impossible »3. J’ai tenté, en d’autres lieux, de résumer ainsi cette période :
Nous étant méticuleusement enfermés dans les contradictions de nos postulats, nous nous enfermâmes aussi, littéralement, dans un lieu clos. Une arrière-salle d’un ancien cinéma de banlieue. Une retraite qui devait tenir lieu pour le Groupov de Factory à la Warhol, l’immodeste comparaison indiquant seulement que rien ne s’y déroulerait selon les processus ordinaires de la production. Ni les rendez-vous, ni les horaires, ni les délais, ni les méthodes, ni les objets de travail, ni leur évolution. Deux refus s’en déduisaient donc immédiatement : celui de la perspective d’un spectacle et celui du texte et même de la parole. Quant au spectacle, cela ne signifiait pas : ne rien montrer. Au contraire.
Il s’agissait bien pour chacun de s’exposer à d’autres dans cette prescription impossible de l’in-ouï. Chaque expérience se tentait dans cette ambition et se livrait hardiment au regard et au jugement. Seulement nous avions convenus que cela se passerait entre nous, d’abord, devant des invités choisis quand le besoin s’en manifesterait, et enfin plus largement si jamais nous accouchions de « quelque chose » qui requit cette présence. Pas de spectacle signifiait aussi que ce « quelque chose » ne relèverait pas strictement de la représentation, parce que précisément le « spectacle » nous paraissait en ce sens haïssable aujourd’hui et la chose du monde la plus commune et la moins urgente. Il n’était évidemment pas question de « théâtre ». Le refus du texte et même, dans un premier temps (plus de trois ans), de la parole, ne s’articulait pas nécessairement au précédent4. Nous n’avions jamais cru que le théâtre ne put exister sans texte ou parole, mais quelque statut expérimental que nous donnions à l’usage des mots, il nous paraissait vivre dans une civilisation si « infectée » sous ce rapport que tout usage verbal allait nous reconduire sur des chemins connus.
De tout ce qui constitue le théâtre nous n’avions gardé que la présentation en chair et en os devant d’autres pour y accomplir des actes qui, pour relever fatalement de l’ordre symbolique, se manifestaient dans la réalité physique. Depuis l’essai lumineux de Walter Benjamin sur l’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité, dans un monde encombré d’artefacts et en route pour le virtuel, nous relevions que le théâtre s’avérait un art archaïque, minoritaire, en quelque sorte résiduaire, et selon le mot de Sartre nous entendions « faire de la maladie une arme ».
Autrement dit, faire advenir des événements dont la violence et la fugacité n’existeraient que dans l’ici/maintenant.
Cela commença, pendant des mois, par un exercice périlleux que nous appelâmes EAA, pour Écriture Automatique d’Acteur. Dépourvus ou sevrés, croyions-nous naïvement, de « conception du monde », nous suivions l’adage « the only way out is in » – à condition bien sûr de l’entendre sans aucune connotation métaphysique. C’était chacun, par des techniques particulières, qui était sommé d’entrer par effraction en lui-même et d’y découvrir en actes, à son propre étonnement, ce qu’il ne savait pas qu’il savait. Au fond, nous tentions le pari que dans les nerfs et les synapses de chacun une part inconnue et singulière de « l’âme historique » pouvait s’extraire, à nulle autre pareille.
Cela différait grandement de l’écriture automatique des surréalistes tant par les buts que par les moyens, ceux d’un « actant » : corps, voix, mouvement, invention d’une temporalité et d’un espace, accessoires, etc. Mais cela engendrait la même difficulté que l’écrit surréaliste : on part à la recherche de l’in-ouï et on rencontre son propre passé. À lire les écritures automatiques d’André Breton on retrouve toute la préciosité de ses écrivains favoris. Nous, nous pelions l’oignon couche après couche, rejetant impitoyablement de ce que chacun présentait tout ce qui « rappelait quelque chose », sans fin...
Nous finîmes par comprendre qu’à défaut d’inouï, la singularité extrême et bouleversante de certaines propositions d’acteurs consistait précisément à accoucher non pas de matériaux absolument nouveaux mais d’un règlement de compte intime avec l’héritage.
Cela prit plus d’un an et demi avant qu’il résulte de ces explorations un événement « public » (une trentaine d’invités), le temps que les planètes individuelles de chacun se constituent et dégagent difficilement les premières lois d’une gravitation où elles ne s’anéantiraient pas réciproquement. L’ensemble de cette soirée se présentait comme une expérience, aussi bien pour ces invités que pour nous-mêmes ; elle durait six heures. Cela s’appelait IL Y A DES ÉVÉNEMENTS TELLEMENT BIEN PROGRAMMÉS QU’ILS SONT INOUBLIABLES AVEC MÊME D’AVOIR EU LIEU.
2. Expérience
Beaucoup de choses ont changé – je n’ose dire « évolué » – depuis cette attitude initiale et ses fulgurances. Du moins, nous les vivions comme telles.
Mais il y a une rémanence jusqu’à aujourd’hui d’éléments fondamentaux de ces débuts, tant au niveau conceptuel que dans celui de la mémoire sensible. Ce très grand choc laissé en nous par ces premières années d’expériences.
Ce sont quelques-uns de ces invariants – quels que soient les déguisements qu’ils aient pu prendre au cours des années – que je tente maintenant d’évoquer en quelques points.
Nous trouvons dans un ancien dictionnaire cette définition :
« EXPÉRIENCE :
1. ACTE d’éprouver, d’avoir
éprouvé. [...]
2. CONNAISSANCE des choses
acquises par un long usage. [...]
3. TENTATIVE pour reconnaître
comment une chose se passe. [...]»
(Littré)
Transposé en Groupov : LA CONNAISSANCE DES CHOSES ne s’acquiert que par un long usage de TENTATIVES pour reconnaître COMMENT ÇA SE PASSE dans l’acte D’ÉPROUVER SOI-MÊME.
Ou encore : l’acte d’éprouver soi-même mène, par un long usage de tentatives pour reconnaître comment ça se passe, à la connaissance des choses.
Ou encore... etc.
Et nous l’entendions bien ainsi pour le « spectateur » également, non qu’il fût appelé à intervenir activement mais à accepter le dérangement insidieux, courtois et impératif de sa fonction et de son attitude pendant toute la durée de l’événement.
Depuis les premières soirées avec « invités » en 1981 (quelques dizaines) jusqu’aux représentations devant des centaines de spectateurs, nous fûmes toujours extrêmement soucieux de créer pour eux un chemin « d’expérience ». Par exemple : on peut soutenir, selon nous, que le spectateur de RWANDA 94 a traversé avec nous les 5h40 (hors entractes) du spectacle en vivant intensément que : « l’acte d’éprouver soi-même mène, par un long usage de tentatives pour reconnaître comment ça se passe, à la connaissance des choses. »
3. Ici/Maintenant
Le point précédent conduit nécessairement à évoquer cette réalité indissociable de l’expérience vécue : elle advient ici et maintenant.
Pour nous, cela postule beaucoup plus que ce qui semble, constituer simplement une donnée de facto de la réalité théâtrale. Comme nous le savons tous, si n’importe quelle représentation théâtrale, médiocre ou sublime, se produit bien ici/maintenant dans un espace/temps commun avec le spectateur, les potentialités artistiques, d’une telle situation hic et nunc, ne sont pleinement mises en jeu qu’à titre exceptionnel.
Rares sont les créations théâtrales qui constituent réellement, pour le spectateur une expérience vécue, au sens fort. Quand cela advient, l’événement laisse en lui une trace pour la vie.
Avoir pu et su créer les conditions où une telle expérience collective advient, reste également exceptionnel pour ceux qui ont eu cette joie. Il n’y a évidemment pas de recette à ce miracle, ni même de méthodologie réutilisable telle quelle projet par projet. Mais, il nous semble cependant qu’en empruntant la via negativa on peut oser formuler quelques conditions dont on soit sûr qu’elles ne permettent pas à une telle expérience de s’accoucher.
- Ainsi, une telle expérience n’a aucune chance de se produire pour le spectateur si le projet initial ne constitue pas un défi qui paraisse, au départ, excéder les forces et le talent de l’équipe de réalisation. Une entreprise que celle-ci vive à la fois comme urgente, inévitable, impérieuse et, en même temps, devant laquelle elle se sente désarmée, sans chemin connu a priori et comme contrainte à s’inventer des méthodes, des recherches, des tentatives de solution jusqu’ici inconnues pour elles.
- Une expérience bouleversante ou révélatrice pour le spectateur n’advient pas non plus si ceux qui ont accouché de cette création et particulièrement ceux qui la font vivre sur scène, n’ont pas eux-mêmes été profondément ébranlés, touchés, instruits, déconstruits, changés, remis en question, par le projet qu’ils ont porté. Les phases de déconstruction d’apprentissage, d’invention, d’essais et erreurs puis, finalement de structuration générale et de cisèlement de détails, tout cela doit être vécu par l’équipe réalisatrice selon un processus organique qui découvre au fur et à mesure ses propres règles.
- C’est aussi pourquoi le temps est toujours un facteur essentiel pour que de telles créations aient une chance d’émerger. Il existe une durée de gestation organique propre à chaque projet, plus ou moins longue, plus ou moins faite d’étapes espacées. Parfois avec des fulgurances s’enchaînant rapidement, mais souvent suivies d’enlisements, de latences, d’incubation lente et apparemment sans effet. Dans tous les cas, jamais des créations telles que 1789 du Théâtre du Soleil, Le Prince Constant de Grotowski, Mistero Buffo de Dario Fo, Paradise Now du Living Theatre, Le regard du sourd de Bob Wilson, etc., jamais aucune création de cette étrange force n’a pu être produite à partir d’un texte disséqué 15 jours à la table et répété 4 à 6 semaines sur le plateau.
4. Hic et Nunc
Revenons à cette revendication du théâtre d’être un acte vivant, partagé ici/maintenant avec le spectateur. Il met souvent en avant cette spécificité pour justifier de sa nécessité.
Cette affirmation mérite d’être examinée de près et, selon nous, fortement nuancée.
D’abord, quantité de spectacles sont également des actes vivants vécus ici/maintenant par un public. Cela va des combats de gladiateurs et des exécutions publiques jadis, à la corrida, aux grands concerts de rock, et bien-sûr – à toutes les formes de compétitions sportives. Ces spectacles vivants sont porteurs – tout comme des productions artistiques – de fortes charges symboliques et sollicitent une vaste gamme d’émotions qui va du rire aux larmes, de l’euphorie ou du ravissement au désespoir, de l’admiration passionnée à la haine, sans oublier de profondes impulsions érotiques. L’intelligence peut même s’y exercer : appréciation du style, évaluation du niveau qualitatif, considérations économiques, réflexions et critiques sur la stratégie, la tactique, etc.
La différence fondamentale est donc ailleurs.
Tous ces spectacles produisent des actes réels et non de la représentation. Certes comme tout acte exposé à un public, ils « représentent ». Ils peuvent, par exemple, incarner des pays, ou bien l’affrontement de l’habileté et de la force, etc. Mais ils ne re-présentent pas. Le taureau est vraiment tué, le boxeur vraiment blessé, nul ne sait le score avant la dernière minute d’un match et on ne saurait le rejouer tel quel le lendemain.
On devrait donc préciser :
Le théâtre, à la différence des autres arts, tire sa force singulière de produire de la réalité vivante sur scène, physiquement, dans un espace/temps partagé, ici/maintenant avec le spectateur. Mais cette réalité se présente ouvertement comme une simulation du réel (on le « joue »).
C’est là un paradoxe très profond... La réalité de la représentation existe bien physiquement dans l’ordre du réel-réel ici/maintenant, mais ce qu’elle met en jeu sur scène, son action (son drama) relève d’un autre ordre, trouble, ambigu.
L’écran qui brûle ne détruit pas le film et, si la pellicule brûlait, le film existerait toujours ailleurs. Un incendie sur scène anéantit la représentation, seule réalité théâtrale concrète5. Si l’acteur meurt en scène à l’acte 2, il n’y aura pas d’actes 3 et 4. Cependant, la concrétude vivante de la représentation se produit au croisement indécis de deux réalités hétérogènes. Celle, disons, du réel-réel et celle du simulacre. Définir ou situer le niveau ou la nature du réel-en-scène peut être extrêmement délicat.
5. Qui pleure ?
Un acteur, au détour d’une réplique ou d’un geste de son partenaire, est suffoqué par l’émotion et se met à pleurer – c’est dans les larmes, pour un certain temps, qu’il continue cependant à jouer…
Qui pleure ?
Bien sûr, dans un contexte scénique, c’est le personnage, un être fictif. Mais ce sont néanmoins les glandes lacrymales de l’acteur qui les produisent, une réalité du réel-réel. Et pour que ces larmes adviennent, l’acteur a dû accepter de laisser toucher en lui à des zones secrètes, intimes, qui lui appartiennent en propre, en tant que personne réelle. Nous sommes bien au croisement indécis de deux réalités hétérogènes. Selon moi, la réalité (réel-réel) de l’émotion qui en résulte chez le spectateur – il pleure également ou, au contraire, se referme – n’advient que par l’ambiguïté du statut de réalité de ce moment. Les larmes de l’acteur ne suffisent pas à provoquer cette émotion. Si celui-ci perdait complètement le contrôle de lui-même, incapable de continuer à jouer, le spectateur serait certes très perturbé mais de manière improductive. Il quitterait lui aussi, comme l’acteur, l’ordre de la représentation : ses émotions ne se rapporteraient plus au contexte de la pièce mais au réel-réel de l’acteur en crise. Cependant, en général, l’acteur bouleversé parvient à dire les répliques prévues et, dans ses larmes, réussit à exécuter avec précision sa partition : la gestuelle, les déplacements, etc. Autrement dit, le spectateur est d’autant plus touché qu’il ressent l’acteur à la fois comme « hors-de-lui-même » et en pleine maîtrise. Moment exceptionnel inscrit dans un ensemble où cela, alors, fait sens. Par l’art de l’acteur, cette transgression pondérée manifeste brièvement à un haut degré deux aptitudes propres à notre espèce mais rarement conjuguées : suivre fidèlement un processus conscient (le travail élaboré qui a permis à cet instant de se produire) et, en même temps, se laisser emporter comme dépassé par ses propres émotions.
La transgression pondérée s’apparente à un phénomène transcontextuel. Les larmes du personnage appartiennent au contexte fictif de la fable : elles peuvent même faire partie des didascalies de l’auteur. Les larmes réelles de l’acteur en personnage et en situation frôlent la limite du contexte-des-contextes : l’ordre de la représentation. Celui dont le réel-réel est exclu, celui où l’on ne tue pas vraiment, on ne viole pas vraiment, mais où on peut pleurer vraiment ? Caresser vraiment ? Où se situe la limite ?
L’actrice qui dirait : « Mais je ne suis pas toute nue, c’est Lulu » n’empêche personne de connaitre désormais sa vraie paire de seins.
À peu près tout ce que la représentation met « en jeu » de véritablement puissant présente ce caractère trouble. Roméo et Juliette s’embrassent passionnément, deux êtres de fiction, mais dans cette action « fictive » les acteurs mêlent réellement leurs lèvres, leurs langues, leurs salives… Avec tous les signes de la passion… mais sans s’aimer réellement… afin de procurer du plaisir à un voyeur… et tout cela pour de l’argent… Quel métier est-ce donc là ?
De longue date, la pratique du comédien et celle de la prostitution voisinent. On comprend l’interdiction du théâtre dans plusieurs sociétés, sa condamnation pendant des siècles par l’Eglise, et l’élaboration de formes de représentations tentant de restreindre voire d’éliminer tout ce qui tient à cette interférence de deux ordres de réalité. C’est pourtant là un constituant majeur de la jouissance spécifique à l’art théâtral. Les représentations dont ce trouble est absent s’oublient facilement. La vie scénique dépend fortement de la capacité à faire vivre de manière sensible et signifiante la perturbation de cette limite entre deux réalités hétérogènes.
Et nous revenons par-là, aussi, à Hic et Nunc. Une création théâtrale vécue par le spectateur comme une expérience intense perturbe toujours la limite entre réel-réel et réel du jeu, mais – ce faisant – elle porte à un niveau exacerbé la qualité d’ici/maintenant de la représentation. Le cri (muet ou non) de Mère Courage devant le cadavre de son fils est de cet ordre. Cri vrai, devant un cadavre faux, mais qui advient « comme si » il surgissait « pour la 1ère fois », alors que nous le savons programmé.
6. Moments de grâce
L’acteur à la fois « comme » hors de lui-même, réellement, et cependant en pleine maîtrise, cela devrait pouvoir se produire, idéalement, pour l’ensemble de la représentation. Mais il arrive qu’un moment de grâce advienne au cours d’une soirée par ailleurs très laborieuse, et d’excellents spectacles auxquels on prend le plus grand plaisir ne voit pourtant pas se produire de ces « petits miracles ». Pourquoi ces « petits miracles » ont-ils toujours fascinés le Groupov et hantés tout son travail ? Et pourquoi marquent-ils à ce point l’esprit de certains spectateurs ?
D’une part, je crois que c’est pour ces moments-là que nous continuons d’aller au théâtre, parce qu’ils en constituent la promesse spécifique. Et d’autre part au risque de faire sourire, j’oserais avancer qu’ils incarnent une valeur philosophique. Ils produisent le sentiment (la conviction ?) fugace et en même temps ineffaçable que la vie humaine vaut la peine d’être vécue. Et dans ces moments, ce quelque chose s’éprouve d’autant plus fortement qu’il s’agit d’une sensation à la fois très personnelle, intime, et cependant collectivement ressentie. Ce qui explique peut-être que les spectateurs n’en sortent jamais découragés, abattus, cyniques, même quand ces moments sont advenus à l’évocation d’une situation tragique.
Si cela se produit dans la contradiction entre maîtrise et abandon, et à la limite entre le réel-réel et le réel du jeu, ce trouble n’agit sur nous – comme dans le cas des larmes – que par la perception simultanée d’une transgression et d’une limite réaffirmée. Ce que j’appelle une transgression pondérée.
Je voudrais évoquer ici deux exemples appartenant à l’expérience du Groupov où nous avons vécu concrètement cette réalité d’un événement scénique qui à la fois transgresse et produit « de la limite ».
7. La gestion collective d’une transgression pondérée
En avril 2004, pour la 10ème Commémoration du génocide au Rwanda, le Groupov fut invité à y jouer son spectacle RWANDA 94 UNE TENTATIVE DE RÉPARATION SYMBOLIQUE ENVERS LES MORTS, À L’USAGE DES VIVANTS. Créé en avril 2000 à Liège puis au Théâtre National à Bruxelles, nous avions déjà tourné internationalement cette oeuvre de grande dimension, et nous avions donc une bonne connaissance de la façon dont des publics de cultures différentes la vivaient. Mais nul ne pouvait prédire – même pas les acteurs et musiciens rwandais – comment réagiraient les spectateurs dans le pays même des événements évoqués sur scène.
La période de commémoration au Rwanda (avril-mai-juin), dans notre cas 10 ans à peine après les événements, se déroule dans une atmosphère très particulière. Bourreau, complice, rescapé, la sensibilité de chacun est exacerbée. En même temps, une sorte de chape pèse sur tous, résultant d’un consensus tacite, afin que les émotions soient contenues dans des limites maitrisables évitant toute nouvelle déchirure du tissu social. C’est donc un moment, globalement, à la fois très intense et en même temps fortement contraint.
Le spectacle s’est joué dans ces conditions singulières. Il faut y ajouter encore le poids d’une autre différence avec l’ordinaire du théâtre. Le Groupov avait déployé un grand effort, avec l’aide de diverses associations rwandaises, pour que des rescapés d’origine rurale, vivant loin des villes et financièrement démunis, puissent assister aux représentations. Des transports étaient organisés et une traduction simultanée par oreillettes, en kinyarwanda, était assurée. Une part importante du public – dont aussi de nombreux citadins – vivaient donc le phénomène de la représentation dramatique pour la première fois.
Souvent, la soirée commençait de façon très inhabituelle pour une troupe de théâtre. Par exemple, avec toute la salle tenant des cierges allumés dans des cornets de papier. Discours de diverses personnalités. Un orateur introduit le spectacle et rappelle qu’en période de commémoration il n’est pas permis d’applaudir. Il invite également les mères à voiler les yeux des jeunes enfants au moment où il y aura des images. Etc.6
Quand le spectacle commence enfin, après un bref moment musical où tout se calme, dégageant un silence d’une densité redoutable, Yolande Mukagasana – la rescapée qui ouvre la représentation – assise au loin sur sa petite chaise de fer, prend la parole. Elle va raconter, pendant près d’une heure, six semaines de sa vie pendant le génocide. Elle parle très calmement, à voix presque basse, mais revit en même temps intérieurement ce qu’elle évoque : les barrières, les massacres, sa fuite, ses cachettes, Kigali cimetière à ciel ouvert et, entre autres, la mort de son frère, son mari, ses trois enfants…
Dès ce début, la relation du public à ce récit et à sa narratrice atteint un niveau d’intensité exceptionnel et se produisent ce qu’on pourrait désigner d’abord comme des « perturbations ». Si la majorité demeure extrêmement concentrée, même dans les larmes qui répondent à celles, silencieuses, de Yolande en scène, d’autres spectateurs gémissent, poussent des espèces de cris, entrent parfois dans des états incontrôlés. Yolande suspend alors son récit et des assistants vont trouver ces personnes, certaines sont évacuées. Une structure médicale légère les accueille à l’extérieur et leur prodigue des soins. Yolande reprend alors la parole, toujours aussi calme.
Il faut ici faire deux observations :
A. De telles réactions émotionnelles sont absolument contraires à la culture rwandaise. Elle diffère radicalement, sur ce plan, des cultures des sociétés de l’Afrique de l’Ouest, par exemple. Une maxime morale rwandaise dit : « Les larmes de l’homme coulent vers l’intérieur ». Autrement dit : ne manifeste jamais en public ni chagrin ni désespoir. Si cela vaut d’abord pour le genre masculin, cette prescription vise plus largement toute personne « respectable ». Ce qui arrive donc parfois pendant les commémorations, et que notre spectacle provoquait régulièrement, constituait une transgression culturelle importante. Plusieurs psychiatres en charge des traumatismes engendrés par le génocide estiment que cette transgression est bénéfique. Mais elle est encore hors normes pour la majorité.
B. Pas toutes, malheureusement, mais la plupart des personnes évacuées, après un certain temps revenaient et assistaient au spectacle jusqu’au bout. Il était particulièrement frappant de voir que les mêmes spectateurs si fortement atteints par la première partie, pouvaient, une heure plus tard, rire, commenter entre eux et même applaudir (contrairement au tabou) pendant la conférence qui a lieu au milieu de la représentation.
Le fait que la plupart des spectateurs en crise revenaient ensuite, et le fait que leur malaise, leur sortie, leur retour, n’empêchaient nullement la représentation de se poursuivre, ni les autres spectateurs d’y rester pleinement attentifs et réceptifs, me semble raconter beaucoup sur l’intérêt et la limite de ces effets à caractère cathartiques. L’intérêt, par exemple, c’est que toute la représentation s’en trouvait galvanisée, vécue de part et d’autre de la scène en état d’hypersensibilité et, par là-même, d’autant plus contrainte à l’autodiscipline individuelle et collective, et pour nous à la précision professionnelle. Car, bien sûr, tout cela affectait fortement les acteurs, les musiciens, les techniciens, et même les traducteurs (certains croyaient entendre des gens de leur famille parmi ceux qui manifestaient dans le public leur bouleversement)… Cette symbiose entre scène et salle, à la fois dans l’émotion mais aussi dans le sentiment de devoir ensemble veiller sur l’événement en cours, tout cela créait une relation complexe d’une qualité très rare.
Celle, précisément, d’une transgression collective pondérée dans le cadre vécu d’un ici/maintenant particulièrement intense.
À un autre moment, une actrice se trouve longuement au premier plan, assise face aux spectateurs, et derrière elle, le « Choeur des Morts » (acteurs rwandais) interprète la « Litanie des questions ». Ce déluge verbal, avec orchestre et chant, soulève toute une série de problèmes et pointe des responsabilités historiques. Il est d’un effet assez puissant à la fois sur la sensibilité et l’intellect. Au Rwanda, placée entre ce choeur dans son dos, et le public juste en face d’elle, l’actrice était parfois en larmes (mais absolument pas « en crise »). Lors d’une représentation à Butare, une femme se leva dans la salle, vint vers la scène et, tendant un mouchoir à la comédienne, elle le lui laissa, retournant ensuite à sa place.
Dans ce cas, la spectatrice transgresse et sans y avoir été invitée, la convention du « quatrième mur » séparant scène et salle. En même temps, ce geste d’empathie très émouvant s’impose des limites : discrétion, presque furtivité. Elle n’est pas montée prendre l’actrice dans ses bras, elle n’a pas pris la parole, elle n’a en rien empêché le spectacle de se dérouler. Elle l’a cependant enrichi d’un signe manifestant que le public comprenait intuitivement et partageait avec nous la convention d’une représentation « à la limite » d’elle-même, c’est-à-dire où cette limite reste perceptible dans sa transgression même.
8. Vers une solution imparfaite
Cette préoccupation centrale pour le Groupov de « l’expérience », donc de « la traversée d’un territoire inconnu », j’aurais voulu encore en rendre compte en évoquant « Le chemin de la clairière », ces structures de travail individuel et collectif de 5 jours et 5 nuits en forêt, en silence.
Mais j’ai déjà été, sans doute, beaucoup trop long et puis cela nous entrainerait dans le vaste champ du parathéâtral. Je terminerai donc par une dernière « anecdote » qui date de 2008 et qui me permettait à l’époque d’ouvrir sur une proposition plus générale, celle d’une dramaturgie pour les temps présents.
En ce moment, ce soir même encore, le Groupov joue pour la troisième saison LA MOUETTE de Tchekhov au Théâtre national et, la veille de la générale publique, le doyen de notre distribution, qui joue bien sûr Sorine, Maurice Sévenant, 76 ans, a fait une grave hémorragie. Il est toujours hospitalisé aux urgences où, cette nuit, il a de nouveau perdu beaucoup de sang. Dans ces conditions, il était évidemment tout à fait impossible, beaucoup trop tard, pour envisager un remplacement. Donc la générale, la première, les représentations jusqu’à ce jour et dans maintenant quelques heures, se font avec moi, le metteur en scène, qui donne les répliques et fait même un peu semblant de consulter régulièrement la brochure qu’il tient en mains, bien qu’il connaisse le texte par coeur. Je ne prétends pas « être », ni même jouer Sorine, mais j’indique assez nettement (physiquement et vocalement) ce qui devrait être joué pour que mes partenaires puissent pleinement s’exprimer et la représentation se dérouler au mieux dans ces conditions anormales.
Alors, depuis quelques jours, je vérifie quelque chose de bien connu, mais toujours extrêmement émouvant et instructif : le public est d’autant plus attentif, mentalement actif, à l’affût du moindre signe, à cause de cette distanciation bien involontaire qu’introduit soudain cette absence et, a priori, cette déficience. Et davantage : il soutient ce qui advient. Il y a mise à distance et, en même temps, empathie.
Autrement dit, quelque chose se passe dans l’ordre de l’ici et maintenant dont on dit sans cesse qu’il différencie le théâtre des arts de la reproduction industrielle mais dont en fait cela ne constitue presque jamais la base de la pratique. Il est remarquable qu’une partie de la force que nous tirons pour l’instant des représentations, vienne de la solution imparfaite d’une faiblesse, d’un manque. Et je pense que d’une certaine manière, la solution imparfaite d’une faiblesse ou d’un manque pourrait bien constituer la ligne directrice d’un « petit organon » d’une dramaturgie d’aujourd’hui.
Jacques DELCUVELLERIE
Novembre 2016
1 Éric Duyckaerts, philosophe et plasticien, membre du Groupov de 1980 à 1987.
2 Sur la limite vers la fin. Repères sur le théâtre dans la société du spectacle à travers l'aventure du Groupov (roman) par Jacques Delcuvellerie, préface de Georges Banu et Jean-Marie Piemme, Alternatives théâtrales / Groupov, Bruxelles, 2012.
3 Texte écrit en août 1983 par Jean-Marie Piemme, et publié in Alternatives théâtrales n°18,
1984, p. 19.
4 La parole fut cependant bien présente à ce moment dans certaines expériences du Groupov, mais toujours enregistrée, une sorte d’élément scénographique sonore, jamais produite « live » par les actants.
5 La pièce écrite relève de la littérature, non du théâtre comme art.
6 Il faut relever que, chaque fois, le public ne respectera pas ces consignes de convenance. Il applaudira en cours de spectacle, rira à plusieurs endroits, fera un triomphe à la fin. Seules les mères, à juste titre, détourneront les enfants pendant les quelques minutes d’images documentaires.
